Un splendide isolement - La Lettre de La Grande Conversation de Terra Nova
25 au 29 novembre 2024
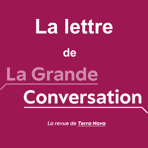
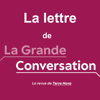
Cette semaine, mardi 26 novembre, les députés français ont trouvé un très large accord… pour exprimer leur opposition, purement déclarative, au projet de traité commercial avec le Mercosur. Le même jour, la Commission européenne rendait son avis sur le budget français pour 2025 et la trajectoire budgétaire de moyen terme visant un retour du déficit public sous la barre des 3% en 2029.
Un splendide isolement
Le budget français pour l’année à venir, qui risque fort de ne pas être voté, affiche un déficit de 6%. Alors que le gouvernement de Michel Barnier n’a pas de majorité pour adopter ce budget et qu’il négocie péniblement sa survie à la censure avec le RN, la Commission européenne a bien voulu considérer le projet français comme « crédible ».
Curieuse journée, au cours de laquelle la singularité de la situation française en Europe est apparue deux fois. La première, dans une incapacité à respecter ses engagements budgétaires ; la seconde, dans notre hostilité solitaire à un accord commercial approuvé par l’immense majorité de nos partenaires. De fait, explique Denis Tersen, la situation de l’économie française explique cette appréhension quasi universellement partagée du libre-échange. Notre capacité à gagner des parts de marché s’est affaiblie et nos entreprises les plus mondialisées n’ont pas besoin de traités commerciaux, ayant installé leurs activités hors des frontières depuis longtemps. La France a-t-elle les moyens de gagner le bras de fer qu’elle a engagé avec ses partenaires européens qui ont beaucoup plus à y gagner ?
L’Europe a encore subi cette semaine une nouvelle secousse, avec les résultats du premier tour de l’élection présidentielle roumaine, qui a vu percer un candidat pro-russe sorti de nulle part. Le phénomène est récurrent : les élections en Europe centrale et orientale sont soumises à des manœuvre d’ingérence russe, plus ou moins sophistiquées, mais désormais systématiques. Ce fut aussi le cas en Moldavie, qui se prononçait ces dernières semaines à la fois sur un référendum constituant qui a inscrit l’objectif d’adhésion à l’Union Européenne dans la loi suprême du pays et pour l’élection présidentielle, qui a reconduit Maia Sandu, la présidente sortante. Elior Chollet présente la situation de ce pays situé aux confins de l’Europe, confronté à une force sécessionniste en Transnistrie, soumis à une intense pression russe mais où les forces pro-européennes ont loyalement remporté l’élection. Un exemple de résistance aux tentatives d’ingérence russe, qui vaut pour toute la région.
LES ARTICLES DE LA SEMAINE
#Moldavie
Élections en Moldavie : une victoire loyale des pro-européens à l’issue d'un combat déloyal
Entre le 20 octobre et le 3 novembre en Moldavie, deux tours d’élection présidentielle et un référendum ont eu lieu. Tous trois avaient pour facteur clivant l’aspiration européenne du pays et tous trois ont été marqués par l'ingérence russe. Finalement, le projet européen de Maia Sandu, présidente sortante, l’emporte. La Moldavie pro-européenne sort victorieuse d’un combat déloyal qu’elle a mené loyalement. Pour sa part, l’échec de Moscou interroge, même si ce revers ne saurait annoncer le crépuscule du soft-power russe, comme en témoigne le cas Géorgien.
#Mercosur
UE – Mercosur : pour la France, il n’y a pas de commerce heureux
L’unanimité inattendue de la classe politique française contre le projet d’accord entre l’Union européenne et l’ensemble de pays sud-Américains rassemblés dans le Mercosur indique une singularité de notre pays au sein de l’Europe. De fait, la situation de notre système productif ne nous permet pas de tirer autant d’avantages des accords de libre-échange que nos partenaires européens. Pourquoi sommes-nous conduits à ce combat défensif isolé ? Peut-on en sortir gagnants ?
LES RAPPORTS TERRA NOVA DE LA SEMAINE
| Investir dans la transition écologique : quel financement des infrastructures ? |
| Le déploiement de la CSRD : pour un changement de posture plutôt qu’un moratoirePar Bertrand Desmier et Martin Richer |
Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram
La Grande Conversation est la revue intellectuelle et politique de Terra Nova
À travers des publications, des analyses, des articles, nous donnons la parole à la contradiction et à la diversité des points de vue sur les défis du moment.




