Climat : des outils pour faire face au changement - La Lettre de La Grande Conversation de Terra Nova
10 au 15 novembre 2024
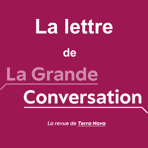
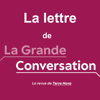
A nouveau, les effets du changement climatique se font sentir en Europe à travers les pluies torrentielles provoquant des inondations. Une série de défis pratiques sont donc désormais posés : comment mettre en œuvre et financer la préservation des espaces naturels ? Comment préparer les populations ? Quelles sont les autorités politiques les mieux placées pour agir lors de catastrophes ? Comment financer la prise en charge du coût des destructions et des réparations ?
Climat : des outils pour faire face au changement
Les catastrophiques inondations dans la région de Valence en Espagne ont un coût humain particulièrement lourd. Les pluies et les torrents de boue ont aussi provoqué d’importants dommages matériels dont le coût reste à évaluer. Cet épisode prend place dans une suite de catastrophes dont la fréquence augmente, comme le montre Thierry Pech en retraçant leurs occurrences mais aussi leur sinistralité. Devant la recrudescence des dommages, la capacité de nos systèmes assurantiels à couvrir les frais n’est plus assurée, à moins d’augmenter très fortement les primes de risque. Même le dispositif français destiné à couvrir les catastrophes naturelles, qui s’est montré jusqu’ici très robuste, n’a plus de réserves suffisantes pour faire face aux événements à venir.
Les dommages liés aux inondations ont été aggravés par l’incurie politique des autorités régionales de la communauté autonome valencienne aussi bien dans l’anticipation des risques que dans le déclenchement des secours aux victimes. Le modèle fédéral espagnol s’est trouvé mis en cause à cette occasion. Un retournement de l’opinion espagnole au sujet des bienfaits du régionalisme est-il en cours ? Les dernières élections européennes ont en tous cas montré un recul des listes régionalistes qui semblaient avoir le vent en poupe en Espagne, mais aussi en Italie, en Belgique ou encore en Ecosse, montre Louis Andrieu. Comment expliquer ce mouvement observable dans ces pays dont l’unité nationale semblait encore, il y a peu, menacée par le réveil régionaliste ?
Les pluies torrentielles et les inondations sont des effets déjà visibles du changement climatique. Pour lutter contre la dégradation de notre climat, la préservation des très grandes forêts est essentielle. Aider le Brésil à préserver la forêt amazonienne est donc un objectif d’intérêt mondial. Diverses modalités d’aide sont possibles. Le Brésil propose pour sa part un « fonds de conservation » qui sera présenté lors du prochain G20 qui se déroule au Brésil la semaine prochaine (18-19 novembre). Alain Karsenty analyse ici dans le détail le montage de ce dispositif et explique les risques associés au projet brésilien, tels que de trop faibles incitations et l’absence de contrôle sur l’utilisation des sommes récoltées.
LES PUBLICATIONS DE LA SEMAINE
#Inondations
Catastrophes naturelles : tensions sur le système assurantiel
Pour faire face aux dommages causés par les catastrophes naturelles, la France s’appuie sur le dispositif « CatNat », conçu pour mutualiser les coûts. Cependant, la fréquence accrue de ces événements, notamment due au changement climatique, et l’augmentation continue de leur coût financier remettent en question la viabilité de ce système.
#Europe
L’étrange recul des régionalistes en Europe
Dans les années 2000, il semblait que la construction européenne favorisait l’affirmation des régionalismes au détriment des ensembles nationaux. Or, les élections de juin dernier montrent un mouvement inverse. Assiste-t-on à un recul de la revendication autonomiste ? Ou à de nouveaux équilibres politiques et institutionnels entre Etats centraux et aspirations régionales ?
#Brésil
Forêts tropicales : questions sur le fonds de conservation proposé par le Brésil
Le Brésil, à l'instar d'autres pays possédant des forêts essentielles pour l'équilibre planétaire, doit préserver l'Amazonie. Pour contrer la déforestation, des outils financiers existent déjà et de nouveaux mécanismes sont en développement. Cependant, il est crucial de ne pas financer le statu quo et il faut en outre s'assurer, avec l’accord et la participation des pays bénéficiaires, que les fonds dédiés à la protection de la forêt soient utilisés de manière optimale.
LE RAPPORT TERRA NOVA DE LA SEMAINE
Nouvelle-Calédonie : sortir de la violence, renouer le dialogue |
Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram
La Grande Conversation est la revue intellectuelle et politique de Terra Nova
À travers des publications, des analyses, des articles, nous donnons la parole à la contradiction et à la diversité des points de vue sur les défis du moment.



